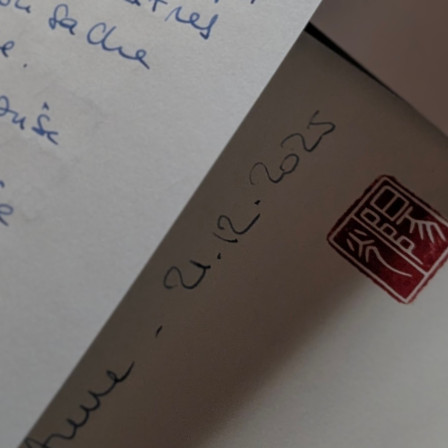J'aime beaucoup Nath Sakura, j'aime ses photos, j'aime sa façon de penser le monde, d'être iconoclaste, un puits de science, une femme drôle et profonde. J'aime aussi sa façon de partager ce qu'elle sait. En technique photographique, en histoire de l'art. Notamment.
L'autre jour je regardais cette conférence.
Avec l'amer (en fait, non, rigolard) constat que j'avais vraiment peu écouté - et tout oublié - de mes cours de physique. Me revoici donc, oreilles grandes ouvertes, à l'entendre dire quelque chose que nous savons tous déjà mais qu'on oublie.
On ne voit pas. Les gens, les objets, rien. On voit ce que fait la lumière quand elle se reflète dessus.
Je me suis figée net.
Pas tellement pour cause de révélation technique sur la photo, j'ai passé l'hiver à essayer de mesurer la lumière pour en faire des photos regardables, lumière incidente et lumière réfléchie me sont devenues familières. Au moins il y a quelque chose dans le lot qui réfléchit - pas toujours moi.
Photographier, c'est littéralement dessiner avec la lumière. En faire émerger un morceau de notre vérité intime.
Ce qui m'a attrapée au vol c'est le côté métaphorique de cette phrase.
J'ai l'impression qu'elle parle d'une certaine façon d'être au monde.
Qu'il s'agisse de tisser des liens avec des gens, de considérer une forme de beauté, d'écrire, de photographier, il me semble que, oui, ça me ressemble. Éclairer juste assez pour créer du contraste, la lumière qui met l'ombre en valeur et l'inverse.
Tout le monde sait maintenant que j'ai une fascination pour le toit du bureau mais tout le monde n'a pas remarqué qu'en hiver, j'y cherche les points de lumière qui éclairent la nuit, en été les ombres et nuances qui compensent la brutalité du soleil. J'écris en cachant des informations essentielles à la vue de toutes et tous. Il faut savoir regarder dans les recoins pas éclairés pour savoir ce que je dis vraiment, être dans la bonne résonance, la plupart des gens, même très proches, ne voient pas tout (ça n'est pas un reproche). Parfois une seule personne peut savoir, mais seulement si elle a envie de chercher un peu ce qui n'est pas en pleine lumière.
Bref. Je joue de la lumière pour créer de l'ombre autant que pour admirer son reflet.
Ce qui m'importe, qui m'émeut, qui compte pour moi c'est ce qui se passe quand un peu de lumière frôle les âmes. Dans presque tous les domaines.
Pas forcément le plus confortable quand c'est mon regard qui éclaire. Mais souvent tellement plus vrai que n'importe quel masque.